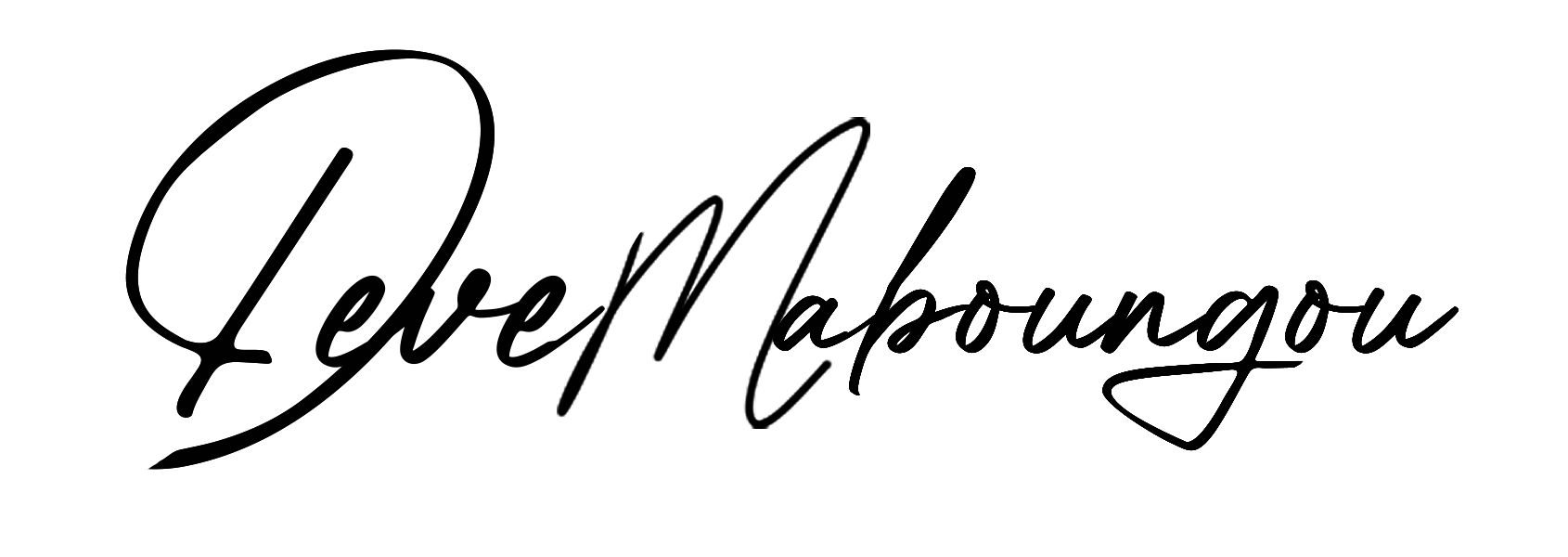L’Afrique contemporaine connaît un paradoxe troublant. Soixante ans après l’indépendance, le continent demeure profondément dépendant des architectures institutionnelles conçues en Occident. Constitutions décalquées sur des modèles européens, systèmes judiciaires transplantés sans adaptation, structures administratives calquées sur les anciennes métropoles coloniales. Pour sûr, l’Afrique s’est engagée dans une entreprise massive de mimétisme systémique.
La question fondamentale se pose avec acuité : pourquoi une Afrique riche en ressources naturelles et potentiel démographique reste-t-elle enchâssée dans des cadres institutionnels qui ne sont ni les siens, ni adaptés à ses réalités ? Et surtout, comment cette dépendance fragilise-t-elle la capacité du continent à s’affirmer comme acteur autonome dans l’ordre géopolitique mondial.
I. Les Racines du Mimétisme
Le mimétisme africain n’émerge pas ex nihilo. Il plonge ses racines dans le projet colonial qui reposait sur l’assimilation des élites africaines aux valeurs, aux catégories et aux structures occidentales. La colonisation a imposé une violence épistémologique fondamentale : celle du doute dans la capacité des Africains à concevoir des systèmes politiques viables sans tutelle extérieure.
Dès l’indépendance, les élites dirigeantes, formées dans les universités occidentales, avaient intériorisé une vision de la modernité politique inséparable du modèle occidental. La démocratie libérale, la séparation des pouvoirs, l’État-nation souverain semblaient universels et incontournables. C’est ce que Cheikh Anta Diop qualifiait d’« aliénation mentale » autrement dit la capacité du colonialisme à s’installer non dans les fusils mais dans les esprits.
Depuis 1990, cette normalisation s’est approfondie. Les transitions démocratiques imposées ont systématiquement érodé les expériences institutionnelles originales qui s’étaient développées dans les années 1970-1980. Les pays ayant tenté de conjuguer principes démocratiques et particularités locales se sont graduellement alignés sur un modèle monolithique : présidentialisme, multipartisme électoral, séparation rigide des pouvoirs.
Les États africains subissent un enserrement normatif dense élaboré par les organisations internationales, les institutions de Bretton Woods et les agences bilatérales. Un État souhaitant restaurer la place des autorités traditionnelles ou instituer des mécanismes de justice restaurative se trouverait confronté à des avertissements sur la « démocratisation ». Le cadre normatif international fonctionne comme un verrou maintenant l’Afrique dans une posture d’imitation perpétuelle.
II. Les Manifestations et les Coûts du Mimétisme
Le premier coût du mimétisme est visible dans l’ineffectivité institutionnelle. Entre 2000 et 2023, plus de 15 États africains ont connu des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Au-delà des coups d’État militaires, ce sont les manipulations constitutionnelles « légales » qui caractérisent le paysage africain : allongement des mandats présidentiels, restriction du droit de vote, concentration des pouvoirs.
Les cadres institutionnels importés ne disposent pas de racines dans les cultures politiques locales. Une constitution fonctionne efficacement non parce qu’elle est bien rédigée, mais parce qu’elle incarne le consensus politique et social d’une communauté. Les acteurs la respectent parce qu’ils y reconnaissent l’expression de leurs valeurs partagées.
Les systèmes judiciaires formels africains illustrent ce dysfonctionnement. Conçus sur les modèles français ou anglosaxons, ils présentent des taux d’accès dramatiquement bas pour les populations rurales. Coûteux, lents, perçus comme externes à la communauté, ils fonctionnent comme des instruments de contrôle davantage que comme des mécanismes de justice. Les systèmes de justice traditionnelle, malgré les efforts de marginalisation, persistent — non par résistance à la modernité, mais parce qu’ils disposent d’une légitimité que les systèmes formels n’ont jamais acquise.
Le paradoxe le plus frappant réside dans la faillite du modèle démocratique importé. Les données d’Afrobarometer révèlent qu’un effondrement progressif de la légitimité du système électoral : seuls 41% des Africains affirment que le multipartisme a amélioré leur quotidien. Depuis 2019, on observe un retour des putschs militaires, notamment dans le Sahel, accueillis souvent avec indifférence ou soulagement.
En contraste, les chefferies traditionnelles maintiennent une confiance populaire de 56% en moyenne (atteignant 87% en Éthiopie, Mali, Niger). L’Afrique n’a pas échoué à cause de la démocratie, mais à cause du type spécifique de démocratie imposé à savoir une démocratie électorale formelle détachée des mécanismes participatifs organiques : l’arbre à palabre, les assemblées de sages, la consultation des anciens, les conseils de chefs.
III. Les Voies de la Réappropriation Authentique
La véritable décolonisation institutionnelle réside dans une hybridation critique et consciente : une « créolisation institutionnelle » où l’on désosserait intelligemment les modèles occidentaux et les héritages africains pour en extraire les principes féconds et les recombiner selon les exigences du présent.
De nombreux pays africains explorent cette voie. Le Ghana a constitutionnellement protégé l’institution des chefferies traditionnelles. La Côte d’Ivoire a créé une Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Le Mali explore comment les institutions traditionnelles de délibération pourraient s’articuler avec les structures démocratiques modernes. L’Ouganda reconnaît officiellement quatre monarchies traditionnelles.
L’efficacité politique ne réside pas dans la pureté conceptuelle d’un système, mais dans sa capacité à enraciner l’autorité dans la légitimité populaire. Un système où les élites élues travaillent en partenariat avec les chefs traditionnels, où les décisions impactant la communauté émergent d’une consultation véritable, offre une redondance de contrôle favorable à l’intégrité.
Au-delà de la chefferie, l’Afrique recèle des traditions de participation politique extraordinaires. Les assemblées communautaires où les décisions émergeaient du consensus incarnaient une forme de démocratie directe. Le Mali précolonial était structuré par des institutions comme le Gbagna (assemblée des notables) et le Kora (conseil de sages). Les peuples du Cameroun bamiléké ont conservé des formes de gouvernance locale d’une sophistication remarquable.
L’enjeu est de redécouvrir ces traditions non comme des curiosités folkloriques, mais comme des ressources intellectuelles et politiques. Il s’agirait de les moderniser en les dotant de règles écrites, de structures de représentation urbaine plutôt que de les abandonner au profit d’importations institutionnelles.
Au-delà des transformations institutionnelles, la réappropriation authentique exige une révolution épistémique. L’Afrique doit reconquérir le droit à la pensée autonome, à l’innovation conceptuelle. Cheikh Anta Diop appelait de ses vœux une « deuxième indépendance » celle de l’esprit. Cette autonomie n’implique pas isolationnisme, mais le droit d’interpeller, de critiquer, de reformuler les théories « universelles » à la lumière des propres expériences africaines.
IV. L’Enjeu Géopolitique
L’africanité, cette affirmation consciente et autonome de systèmes de pensée, d’organisation et de valeurs africains constitue une condition de la puissance africaine future. Les puissances qui comptent sur la scène mondiale possèdent une vision civilisationnelle propre. A titre d’illustration, la Chine exerce une attraction par un modèle d’État puissant et d’efficacité économique. La Russie par l’affirmation d’une civilisation orthodoxe distinct de l’Occident. L’Inde par un modèle démocratique enraciné dans les traditions hindoues.
L’Afrique, a contrario, exporte son talent intellectuel, ses cadres, ses ressources naturelles en proposant un modèle alternatif crédible de gouvernance parfois contesté. Elle demeure un imitateur, une sorte de mauvais calque de l’Occident. La redécouverte et la modernisation de l’africanité ne constituent pas un exercice nostalgique. C’est une condition de l’autonomie stratégique, de la capacité à s’affirmer comme sujet plutôt que comme objet des relations internationales.
Le mimétisme africain n’est ni une fatalité ni le résultat d’une incapacité, c’est un choix fait sous des conditions de contrainte. Le temps est venu de le questionner consciemment et d’explorer des voies d’affirmation autonome.
Cela ne signifie pas rejeter la modernité ou les standards internationaux, mais reconnaître que la modernité n’est pas univoque, que l’Afrique dispose des ressources intellectuelles, culturelles et historiques pour inventer ses propres réponses aux défis du XXIe siècle.
L’enjeu fondamental est de passer d’une posture d’imitation à une posture d’innovation créatrice. L’Afrique ne cessera d’être mimétique que lorsqu’elle aura reconquis l’autorité de définir ses propres questions et d’élaborer ses propres réponses. Cette reconquête constitue l’une des grandes tâches intellectuelles et politiques du continent pour la décennie à venir. Son succès ou son échec déterminera en grande partie la position de l’Afrique dans l’ordre mondial émergent.